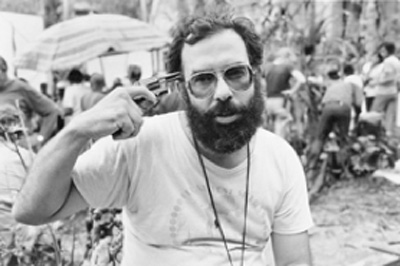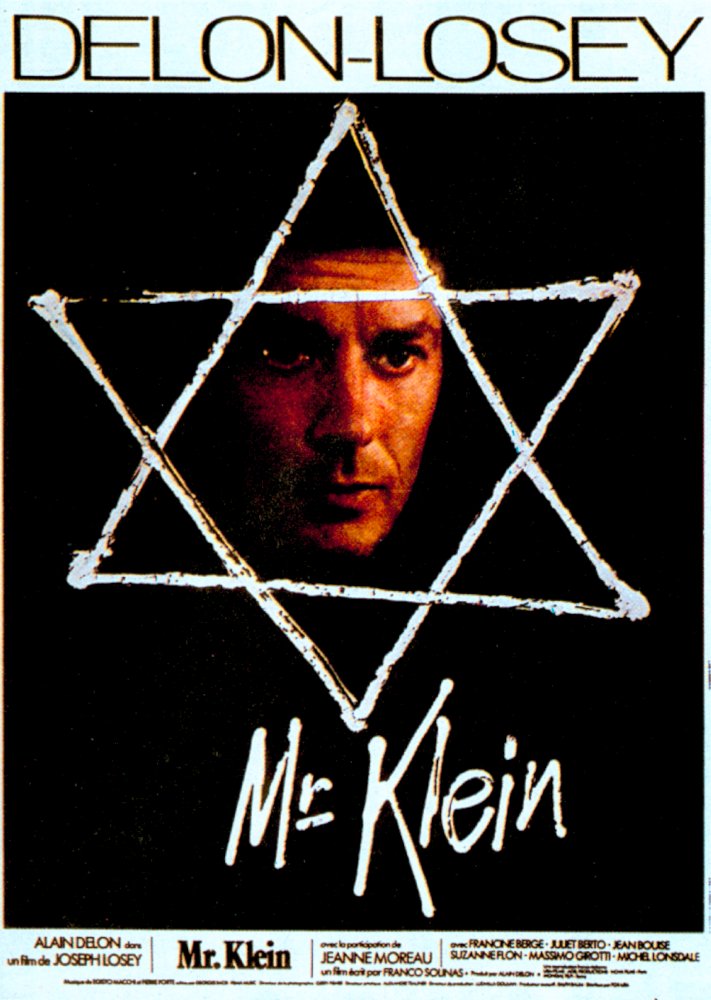Au cours des années 40, à une époque où un film américain était toujours précédé par un dessin animé, il y avait, dans la banlieue de Los Angeles, près de Glendale et Pasadena, une petite ville nommée Toon Town. C’est là que vivaient Donald et Daffy Duck, Mickey et Minnie Mouse, Tom et Jerry, Dumbo et Betty Boop. Toon Town, hélas, n’existe plus. Mais c’était, si l’on en croit Robert Zemeckis et Steven Spielberg, la ville-dortoir où les personnages de cartoons (appelés les Toons) venaient se reposer, après une dure journée de travail aux studios de Burbank ou de Culver City, en compagnie d’êtres humains. C’est à bon Town qu’habite Roger Rabbit, un lapin aux oreilles géantes et aux yeux exorbités. Roger, un bon, est la covedette (avec Baby Herman, un quinquagénaire égrillard qui a passé sa carrière dans un berceau) d’une série de dessins animés. A l’écran, Roger Rabbit échappe aux pires périls, de la suffocation à l’électrocution en passant par la raclée et la noyade.
Au cours des années 40, à une époque où un film américain était toujours précédé par un dessin animé, il y avait, dans la banlieue de Los Angeles, près de Glendale et Pasadena, une petite ville nommée Toon Town. C’est là que vivaient Donald et Daffy Duck, Mickey et Minnie Mouse, Tom et Jerry, Dumbo et Betty Boop. Toon Town, hélas, n’existe plus. Mais c’était, si l’on en croit Robert Zemeckis et Steven Spielberg, la ville-dortoir où les personnages de cartoons (appelés les Toons) venaient se reposer, après une dure journée de travail aux studios de Burbank ou de Culver City, en compagnie d’êtres humains. C’est à bon Town qu’habite Roger Rabbit, un lapin aux oreilles géantes et aux yeux exorbités. Roger, un bon, est la covedette (avec Baby Herman, un quinquagénaire égrillard qui a passé sa carrière dans un berceau) d’une série de dessins animés. A l’écran, Roger Rabbit échappe aux pires périls, de la suffocation à l’électrocution en passant par la raclée et la noyade.
Dans la vie, il est marié à une actrice animée comme lui, Jessica. Jessica est une vamp aux seins énormes et à la cuisse légère. « Je ne suis pas méchante, dit-elle, je suis simplement dessinée comme ça ». « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? » est une merveille de film qui mélange personnages animés et humains, les faisant coexister et dialoguer avec une interaction parfaitement crédible, et une virtuosité technique sans précédent. Certes, le mélange de personnages animés et d’acteurs n’est pas une nouveauté. « Mary Pop-pins » et « Song of the South » avaient utilisé le procédé et Jerry la souris avait dansé avec Gene Kelly dans « Escale à Hollywood ». Mais ce n’étaient là que de courtes séquences, des morceaux de bravoure faits pour étonner et amuser. Dans « Qui veut la peau de Roger Rabbit ? », le mélange est à la -base même du film. C’est son essence et c’est ce qui fait son originalité. « Situé en 1947, le film raconte l’histoire d’Eddie Valiant (Bob Hoskins), un détective privé devenu alcoolique à la suite de la mort de son frère assassiné par un Toon. Lorsque Roger Rab-bit, accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis, lui demande. de l’aider à se disculper, Valiant refuse. Mais il est entraîné malgré lui dans le monde des bons après avoir visité le Ink and Paint club, une boîte de nuit réservée aux êtres humains, mais où le personnel est composé uniquement de bons, des serveurs (pingouins en smoking) aux musiciens (Daffy et Donald Duck, pour la première fois ensemble, dans un duo de piano qui confine à l’hystérie). C’est d’ailleurs au lnk and Paint club que la femme de Roger, Jessica, chanteuse ensorcelante, se produit. Très vite, Valiant comprend que Roger est innocent et qu’un humain, le sinistre juge Doom (Christopher Lloyd), est le coupable. Doom hait les Toons, qu’il considère inférieurs. Doom est en fait un raciste qui veut exterminer ces personnages qui n’ont que gag en tête. Pour ce faire, il a mis au point l’arme idéale : une mixture composée de benzine et d’essence de térébenthine. En 1982, la firme Walt Disney achète les droits d’adaptation au cinéma d’un roman policier de Gary K. Wolf, « Who censored Roger Rabbit ? », » où un détective privé a affaire à des personnages de « comic strip » dans le Los Angeles d’aujourd’hui.
Un scénario est commandé à deux débutants, Jeffrey Price et Peter Seaman, et envoyé au réalisateur Robert Zemeckis qui, à l’époque, n’a mis en scène que « Used cars ». Mais Disney, alors en plein désarroi financier, se désintéresse complètement du projet. Quatre ans plus tard, Zemeckis tourne « Retour vers le futur » pour le producteur Steven Spielberg. Les deux hommes parlent de « Roger Rabbit ». Entre-temps, Disney a été restructuré et cherche à développer son secteur cinéma. Lorsque Spielberg se déclare intéressé, la machine se remet en marche. Robert Zemeckis demande à Price et Seaman d’écrire un nouveau scénario transposant le film dans les années 40 et intégrant acteurs et personnages dessinés. Toon Town est inventé. Mais, avant de se lancer à l’eau, Zemeckis rencontre Roger Williams, un animateur qui eut son heure de gloire avec la Panthère rose et consacre son talent au film publicitaire en Grande-Bretagne.